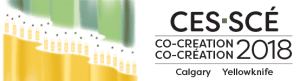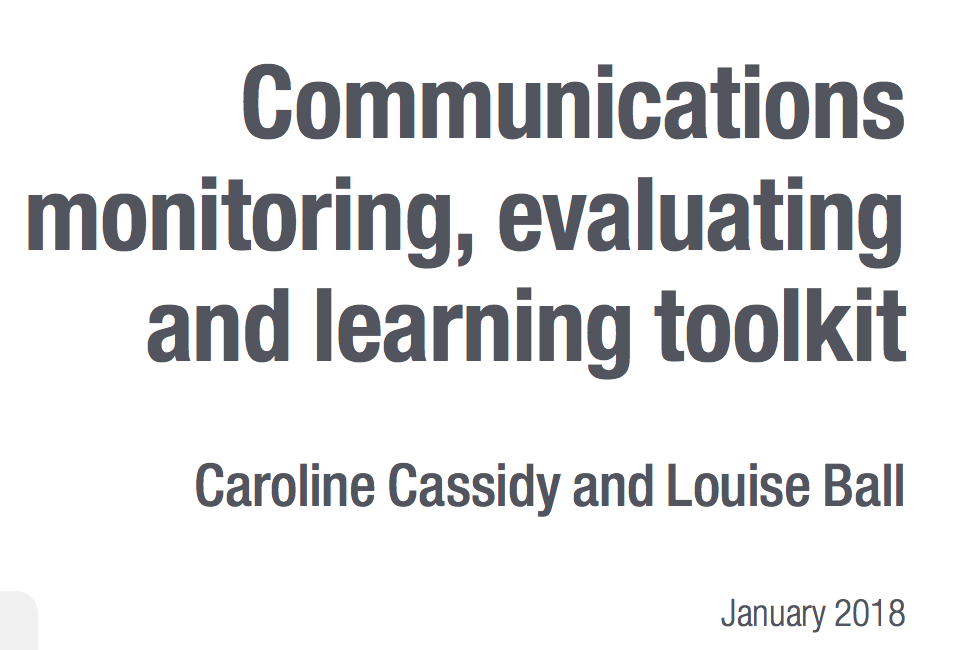1er au 5 octobre 2018, Thessalonique, Grèce
13th EES biennial conference : evaluation for more resilient societies
Un enjeu était de déterminer comment l’évaluation peut aider les sociétés à mieux anticiper les chocs, à y faire face et à se transformer pour devenir plus résilientes. Il s’agit de passer d’une évaluation qui regarde le passé (ce qui a fonctionné ou non) à une évaluation plus prospective, capable d’éclairer les décisions dans un contexte d’incertitude.
Face à la complexité des défis, un enjeu majeur est de repenser les outils de l’évaluation. Cela inclu:
- La pensée systémique : dépasser les évaluations de projets isolés pour comprendre et évaluer des systèmes complexes et interconnectés.
- Les approches participatives : impliquer les citoyens et les parties prenantes dans le processus d’évaluation pour mieux comprendre les contextes locaux et renforcer l’appropriation des solutions.
- Les méthodes mixtes : combiner des données quantitatives et qualitatives pour obtenir une vision plus riche et nuancée des interventions et de leurs effets.
La conférence a questionné le rôle traditionnel de l’évaluateur comme un expert technique neutre. L’enjeu était de promouvoir un nouveau profil d’évaluateur agissant comme un facilitateur du changement et de l’apprentissage.