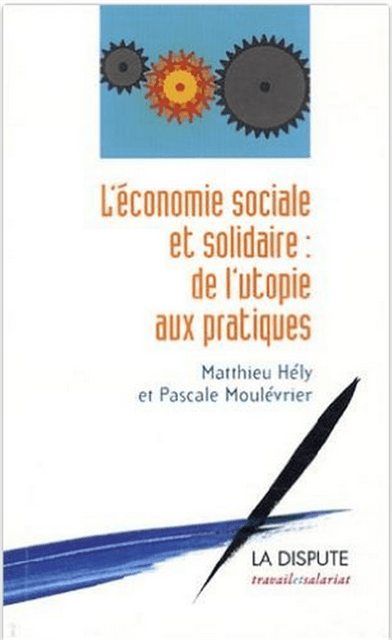Cette page propose diverses ressources pour mieux circonscrire l’économie sociale et solidaire (ESS) et principalement pour appréhender son évaluation. Des articles, des publications, des rapports d’évaluation mais tout d’abord ci-dessous une courte réflexion sur les critères qui pourraient permettre d’évaluer cette économie.
ESS : quelles valeurs, quels principes et sur quels critères évaluer ?
L’économie sociale et solidaire s’appréhende à travers un certain nombre de valeurs. Dans la loi Hamont de 2014, des valeurs déclinées en principes :
- poursuivre un but social autre que le seul partage des bénéfices
- une gouvernance démocratique et participative
- une lucrativité encadrée (notamment des bénéfices en grande partie consacrés au maintien ou au développement de l’activité)
L’évaluation de l’économie sociale et solidaire, quel que soit le périmètre, en tant que politique publique, en tant que contribution à l’intérêt général ou encore à l’échelle des actions ou projets portées par les structures se reconnaissant de l’ESS devrait ainsi porter sur ces valeurs ou sur d’éventuels écarts par rapport à ses valeurs.
Si les structures de l’ESS sont encouragées à s’auto-évaluer en fonction de ces critères (puissance transformatrice, dimension collective et solidaire, responsabilité, émancipation, innovation, dialogue, pratiques démocratiques,…), leurs actions sont toujours appréciés à travers des critères classiques d’efficacité, de performance, de justification de l’impact et à travers des dispositifs de mise en concurrence.
Les plus grands cabinets d’audit financier se positionnent dans l’accompagnement à l’évaluation de l’ESS comme marchés. Le tout dans le cadre de politiques publiques et d’une gouvernance nationale ne disposant pas d’un système de suivi et évaluation établi et fonctionnel, ni même d’une loi d’institutionnalisation de l’évaluation (voir la gouvernance de l’évaluation).
Les politiques publiques à l’échelon national aurait ainsi intérêt à mobiliser les acteurs de l’ESS, déjà partiellement rôdés à l’évaluation de projets dans l’évaluation des politiques publiques dans lesquels ils s’insèrent pour une pratique croisée de l’évaluation.
➡ Il existe une contradiction entre les valeurs de l’ESS (utilité sociale, démocratie, lucrativité limitée) et une évaluation qui utilise des critères de marché classiques (performance, efficacité).
En bref
Comment évaluer l’Economie Sociale et Solidaire : quelques principes et recommandations
- ne pas se limiter à l’évaluation de l’efficacité des structures ou actions de l’économie sociale et solidaire mais incorporer le respect, l’ancrage ou l’écart aux valeurs affichées
- restreindre les accompagnements à la mise en place de système de suivi et évaluation ou les évaluation externes des structures ESS à des acteurs se réclamant des valeurs de l’ESS et non des cabinets d’audit orientés principalement sur la performance
- les structures de l’ESS évaluées doivent exiger l’évaluation des politiques publiques dans lesquelles elles s’insèrent, notamment afin de s’appuyer sur des données plus globales et impulser une responsabilité partagée
Pour partager vos réflexions et échanger sur le sujet :
Groupe d’échanges de pratiques sur l’évaluation de l’utilité sociale :
Repenser l’évaluation de l’ESS : ancrée dans l’intégrité des valeurs, en résonance avec l’évaluation des politiques publiques, centré sur le renforcement des capacités et des moyens d’existence durables
➡ Economie sociale et solidaire : définir et mesurer l’utilité sociale (groupe linkedin)

Pour aller plus loin
Conférence gesticulée
- Je jure de lutter en toute loyauté – ESS117 – L’innovation sociale et la start-up nation – une conférence gesticulée de Gwendal Evenou
Evaluation de l’économie sociale et solidaire
Ouvrages et articles
- L’évaluation de l’économie sociale et solidaire : comment cheminer vers la complexité ? E. Lavoine, F. Ottaviani, PUG, juin 2023
Systématiser la tenue d’ateliers de co-construction des indicateurs d’évaluation, impliquant l’ensemble des parties prenantes du projet (bénéficiaires, salariés, volontaires, partenaires, etc.), au début de chaque démarche d’évaluation. Les auteurs dénoncent la vision dominante de l’impact social comme étant trop technique, dépolitisée et simpliste, souvent déconnectée de la réalité vécue des acteurs et des véritables valeurs de l’ESS et prônent une évaluation qui reconnaît sa dimension construite et axiologique, et non pas objective. Le texte souligne également la concentration sur la mesure de l’impact parallèlement à un oubli des conditions sociales et institutionnelles dans lesquelles cet impact est généré. Aussi, le rapport sous-entend que ces approches « social impact » risquent de dénaturer les missions profondes de l’ESS, en poussant les organisations à adapter leurs projets aux critères d’évaluation plutôt qu’à leurs objectifs sociaux et environnementaux fondamentaux initiaux.
- Avis du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire sur le bilan de la loi 2014, Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, 2023
Cet avis du CSESS sur la loi ESS de 2014 cherche à identifier les écarts entre l’intention législative de la loi ESS et la réalité de la mise en œuvre, pour ensuite proposer des ajustements normatifs (législatifs, réglementaires) ou des politiques publiques.
L’avis révèle une reconnaissance statutaire et une structuration renforcée du secteur, mais une ambition de changement d’échelle non atteinte en raison d’un manque de volonté politique, de moyens financiers et d’une inertie administrative.
La loi visait à concilier utilité sociale, performance économique et gouvernance démocratique, mais les objectifs de développement et de changement d’échelle n’ont pas été pleinement atteints, la part de l’ESS dans l’économie n’ayant pas augmenté comme espéré. La part de l’ESS dans l’ensemble de l’économie (établissements employeurs) est passée de 9.5% en 2013 à 9% en 2019. Le manque de données statistiques fiables sur l’ESS demeure un problème toujours prégnant.
Le document suggère que le gouvernement a parfois utilisé la loi comme un « outil d’affichage politique », promettant un soutien qui n’a pas toujours été concrétisé. L’incohérence entre les textes législatifs (notamment la loi ESS et la loi NOTRe) et la difficulté à faire appliquer certaines dispositions par les exécutifs locaux et nationaux sont également des points critiques masqués par le cadre légal.
- Évaluer l’économie sociale et solidaire : socioéconomie des conventions d’évaluation de l’ESS et du marché de l’évaluation d’impact social, M. Studer, 2022
La thèse de Marion Studer explore l’évaluation de l’impact social au sein de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) comme un objet politique. la technicité des méthodes occulte les enjeux politiques et le contexte de leur émergence. L’auteure suggère que la prolifération des guides méthodologiques tend à présenter l’évaluation de « l’impact social » comme une pratique neutre et indispensable, masquant les luttes d’influence et les différentes visions de ce qui constitue la « valeur » au sein de l’ESS ou du monde associatif au sens large. On perçoit également une tension entre les acteurs « historiques » de l’ESS, qui cherchent à préserver une certaine spécificité et autonomie, et les « nouveaux entrants » (consultants, écoles de commerce) qui importent des logiques managériales et marchandes dans le champ de l’évaluation.
Les organisations de l’ESS devraient chercher à se réapproprier l’évaluation pour qu’elle serve leurs propres objectifs de pilotage et de développement, plutôt que de subir des modèles imposés de l’extérieur. Cela passe par la formation et la montée en compétence des acteurs de terrain.
- L’évaluation de l’apport de l’économie sociale et solidaire, Philippe Frémeaux, Septembre 2013
Le rapport Frémeaux, tout en étant une commande ministérielle, critique implicitement une vision trop économiciste et standardisée de l’évaluation, souvent promue par des approches technocratiques de l’action publique. Il critique le PIB comme mesure de la richesse et du bien-être, plaide pour de nouveaux indicateurs, et explore des méthodes pour apprécier les spécificités et « l’utilité sociale » des organisations de l’ESS. Le rapport souligne le besoin de données statistiques sur l’ESS (contribution à l’emploi, apport du bénévolat, qualité des pratiques d’emploi, spécificité des résultats économiques, qualité de la gouvernance, objets social) et de méthodes d’évaluation pluralistes, co-construites avec les parties prenantes. Il met en garde contre les risques de l’évaluation normative qui bride la créativité et l’autonomie des organisations de l’ESS en se concentrant uniquement sur des indicateurs quantitatifs imposés
➡ l’auteur conteste l’idée d’une évaluation « scientifique » purement objective de l’utilité sociale : l’évaluation est un « construit social » nécessitant une délibération et une convention entre acteurs
- Evaluation du pilotage de la politique publique d’économie sociale et solidaire, Inspection Générale des Finances, Inspection Générale des Affaires Sociales, juillet 2013
Ce rapport évalue le pilotage administratif de la politique publique de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Il diagnostique le cadre administratif existant, jugé complexe et souvent instable, notamment les défaillances perçues de la délégation interministérielle (MIESES) à l’époque. Le rapport propose des scénarios de réorganisation administrative pour améliorer la coordination interministérielle et mieux soutenir le secteur, plutôt que d’évaluer le contenu de la politique elle-même.
L’ESS est un secteur diversifié et en évolution qui nécessite un pilotage interministériel fort, ce qui a fait défaut. Les structures administratives passées pour l’ESS ont fait preuve d’instabilité et d’une efficacité variable, la MIESES d’alors étant considérée comme inadéquate. Le rapport expose une déconnexion entre les ambitions politiques affichées pour l’ESS (par exemple, la nomination d’un ministre dédié) et l’inadéquation des structures de soutien administratif existantes. Le rapport suggère une marginalisation administrative et un manque d’adhésion à l’ESS. Les appels répétés à l' »acculturation », ainsi que la difficulté constatée à mobiliser les administrations, témoignent d’une résistance sous-jacente ou d’une perception de l’ESS comme secondaire.
Articles/Publications
- Travailler sans patron, Mettre en pratique l’économie sociale et solidaire, Simon Cottin-Marx, Baptiste Mylondo, Folio, 2024
Cet essai propose des éclairages pratiques pour encourager des organisations démocratiques, horizontales et autogérées, au-delà des structures hiérarchiques traditionnelles, combler l’écart entre les valeurs affichées de démocratie et d’équité au sein de l’économie sociale et solidaire et leur application réelle dans les structures organisationnelles. Le livre explore des voies pour mettre en oeuvre des structures organisationnelles alternatives.
- L’économie solidaire en mouvement, Josette Combes, Bruno Lasnier, Jean-Louis Laville, 2022
L’ouvrage, publié à l’occasion du 20ème anniversaire du Mouvement pour l’économie solidaire (MES) propose une analyse du développement de l’économie solidaire sur plus de cinquante ans, en France et dans le monde. Une idée clé de l’ouvrage est la reconnaissance de l’économie solidaire non pas comme un simple secteur d’activité, mais comme un mouvement porteur d’un projet politique de transformation sociale et économique.
- La déclaration d’engagement de l’ESS, Pour une République sociale et solidaire : nos raisons d’agir, ESS France, 2021
Cette déclaration d’engagement a été adoptée lors du Congrès de l’ESS le 10 décembre 2021 et exprime l’engagement des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) à orienter le progrès dans toutes ses dimensions. Promouvoir des modèles économiques basés sur la solidarité et la coopération. Egalement à renforcer la démocratie participative dans les processus décisionnels et à encourager une transition écologique inclusive.
- Du social business à l’économie solidaire, critique de l’innovation sociale, Maïté Juan, Jean-Louis Laville, Joan Subirats, mars 2020
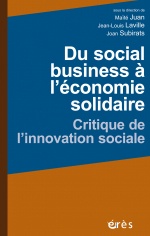
L’innovation sociale est partout considérée comme vertueuse mais cet éloge unanime ne saurait faire illusion. Elle regroupe en fait un ensemble de pratiques très diversifiées, voire divergentes. Deux approches contrastées sont ici dégagées : la première qualifiée de social business se contente d’une amélioration du modèle économique dominant, l’innovation s’inscrivant dans une perspective réparatrice et fonctionnelle ; la seconde, du côté de l’économie solidaire, a pour horizon une démocratisation de la société.
- Les communs de capabilités : une analyse des Pôles Territoriaux de Coopération Economique à partir du croisement des approches d’Ostrom et de Sen, Geneviève FONTAINE, 2019
Cette thèse analyse des Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) en croisant les approches d’Amartya Sen (capabilités) et d’Elinor Ostrom (communs). L’objectif est de construire un cadre d’analyse qui évalue ces actions collectives à l’aune de leur finalité de développement durable, en intégrant des dimensions éthiques, sociales et politiques. Le concept de « communs de capabilités » est proposé comme outil d’analyse, soulignant le rôle du capital social et de la coopération . Le document se pose comme une critique implicite des politiques publiques qui réduisent les PTCE à leur dimension économique, en négligeant leur potentiel de transformation sociale et leur ancrage dans l’ESS. Il y a une volonté de redéfinir l’évaluation des PTCE, en proposant des outils qui valorisent leur impact social, leur gouvernance démocratique et leur contribution à la construction d’une société plus juste et durable.
- Loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 par les acteurs de l’économie sociale et solidaire et le conseil national des CRESS, décembre 2014
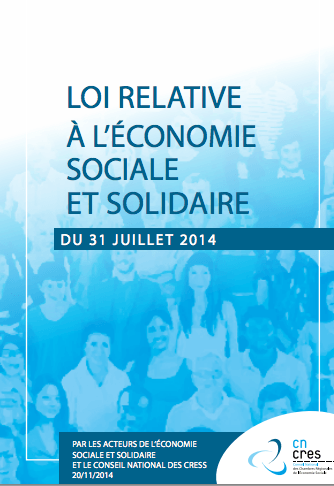
En une trentaine de pages, une lecture de la loi ESS du 31 juillet 2014 par un échantillon de ces représentants : le Mouves, le RTES, le Labo de l’ESS, Les SCOP, la Mutualité Française, le Mouvement Associatif, et la Plate-forme Pour le Commerce Equitable. Le tout coordonné par le CNCRES avec un soutien de la Caisse des Dépôts.
- Vivre ensemble, une utopie nécessaire ? Martine Le Poulennec, janvier 2014
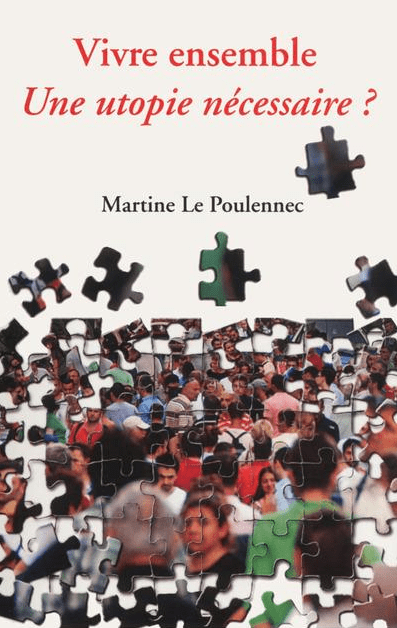
Le « Vivre ensemble » fait partie de ces concepts ressassés tant par les politiques que les médias. A l’heure de l’individualisme, de la peur de l’autre, de la concurrence exacerbée entre les individus, des injustices flagrantes tant économiques que sociales, du repli sur soi et du communautarisme, cette expression a-t-elle encore un sens ? Que signifie-t-elle pour les simples citoyens que nous sommes ? La qualité des liens sociaux tient d’abord aux acteurs eux-mêmes : citoyens, consommateurs, habitants des territoires, hommes et femmes de tous âges, de toutes origines, de toutes professions.
- L’économie sociale et solidaire : de l’utopie aux pratiques, Matthieu Hély, Pascal Moulévrier, La Dispute, coll. « Travail et salariat », 2013
Cheville ouvrière de nombreuses politiques dans le domaine de l’insertion par l’activité économique, des services à la personne, du soin, de l’accès au crédit, etc., l’économie sociale et solidaire est considérée comme une solution d’avenir face à l’affaiblissement de la cohésion sociale engendré par la crise. « Alternative au capitalisme » selon les uns, remède à la « crise de l’État-providence » selon les autres : qu’en est-il réellement et que peut-on en attendre ?
- Code de l’économie sociale et solidaire en France, Wilfried Meynet, Larcier, 2012
Ce recueil qui compile les principaux textes juridiques et fiscaux applicables aux diverses entités de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). L’ouvrage couvre les associations, fondations, fonds de dotation, coopératives, mutuelles et syndicats visait à fournir un outil de référence pour les acteurs de l’ESS, en consolidant l’ensemble des règles encadrant leurs activités et leur fonctionnement en France.
- La solidarité au défi de l’efficacité, Nouvelle édition, Thierry Jeantet, La Documentation Française », Economie sociale (n.5297/98) – 2009
L’ouvrage explore les défis posés à la solidarité face aux exigences d’efficacité dans l’économie sociale. Il aborde les contraintes légales, les aspects philosophiques et éthiques de ce secteur. Il présente les règles et principes juridiques communs aux acteurs de l’ESS.
- L’économie sociale et solidaire n’existe pas, Matthieu Hély, La vie des idées, février 2008
L’article soutient que la promotion du secteur associatif sous l’étiquette d' »économie sociale et solidaire » masque en réalité un désengagement de l’État et une précarisation du travail, plutôt qu’un réel dépassement des logiques marchandes et publiques.
Il éclaire l’écart fondamental entre le discours enchanteur sur l’ESS (démocratisation de l’économie, solidarité, bien commun) et la réalité qu’elle recouvre : précarisation, désengagement de la fonction publique, stratégies d’adaptation individuelle face à la raréfaction des emplois publics et aux carrières discontinues. La critique du « bénévolat de compétences » promu par de grandes entreprises laisse entendre une instrumentalisation du secteur associatif à des fins d’image et de cohésion interne, voire de contournement des conditions de travail classiques. Concernant le secteur associatif, un enjeu est la formalisation des principes et des critères qui organisent le protocole d’évaluation de l’utilité sociale des associations.
➡ Une lecture critique et désenchantée de l’ESS, reliée directement à la dérégulation du travail et à la transformation de la fonction publique. L’analyse de Matthieu Hély déconstruit les discours dominants pour révéler les rapports de pouvoir et les inégalités sous-jacentes.
- L’économie solidaire, une perspective internationale, Jean-Louis Laville, nouvelle édition, Paris, Hachette, 2007
L’ouvrage rassemble huit synthèses de recherche menées dans divers pays et continents par des universitaires européens, québécois et chiliens. Il examine les nouvelles formes d’économie solidaire qui ont émergé au cours des quarante dernières années. Cette synthèse souligne notamment la nécessité de reconnaître et de soutenir l’économie solidaire sur un plan institutionnel.
- Dictionnaire de l’autre économie, Jean-Louis Laville et Antonio-David Cattani, Desclée de Brouwer, Paris, 2005
Une œuvre collective de plus de 50 auteurs internationaux. Il présente une multitude de termes liés à une économie alternative. Ce dictionnaire met en lumière des pratiques économiques variées à travers le monde, souvent axées sur la coopération, le don et les échanges non marchands et non monétaires. L’objectif est de rendre visible une économie existante mais occultée par les discours économiques dominants.
- Économie solidaire et démocratisation de l’économie, Laurent FRAISSE, Hermès n°36, 2004
Ce chapitre part du constat que la sphère économique est souvent perçue soit comme un lieu de rapports de force, soit comme un espace d’échanges basés sur des calculs individuels, mais rarement comme un espace public de délibération et de décision. Il questionne la séparation moderne entre l’économique et le politique, qui tend à soustraire les activités de production, d’échange et de consommation aux principes démocratiques. L’auteur cherche à comprendre comment les initiatives d’économie solidaire, au niveau micro-économique, expérimentent des formes de démocratisation de l’économie par la création d' »espaces publics de proximité ». Au-delà de ces initiatives locales, le texte soulève la question plus large de l’institutionnalisation d’une économie plurielle.
- Le tiers secteur. L’économie sociale et solidaire : pourquoi et comment ? Paris, La découverte, Alain Lipietz, 2001
L’ouvrage analyse l’émergence d’un tiers secteur face aux limites de l’État et du marché. L’ESS pourrait être une réponse politique à la crise de légitimité des modèles traditionnels (État, marché). L’auteur positionne l’ESS non comme une simple béquille sociale, mais comme un laboratoire d’innovation institutionnelle et sociale, susceptible de réinventer le contrat social. On perçoit également une volonté de redonner du sens à l’action collective, de combler le vide laissé par le retrait de l’État-providence et la fragilisation des solidarités traditionnelles. L’appel à une loi-cadre traduit une ambition de reconnaissance et d’institutionnalisation du secteur, tout en révélant la diversité et parfois la fragmentation de ses acteurs.
Rapports
- Rapport parlementaire sur le développement de l’économie sociale et solidaire, Francis Vercamer, Avril 2010
Le rapport rappelle que l’ESS « englobe historiquement les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations ». Ces formes organisationnelles ont des racines anciennes, souvent issues des mouvements ouvriers, paysans ou philanthropiques du 19ème siècle, cherchant des alternatives au capitalisme naissant ou des réponses à des besoins sociaux non couverts par le marché ou l’État. Le rapport est une commande gouvernementale (Gouvernement Fillon, 2009) et Francis Vercamer était député (Nouveau Centre à l’époque).
Le rapport souligne que « les différents acteurs de l’économie sociale ont peu l’habitude de travailler ensemble, dans une optique transversale » avec un manque de cohésion et de leadership unifié au sein de l’ESS, nuisant à sa reconnaissance et à son influence. Il souligne une inquiétude face au transfert de risques par les services publics vers les associations avec un besoin de « sécurisation » des financements, laissant entrevoir une relation parfois déséquilibrée où l’ESS pourrait être vue comme un simple exécutant de politiques publiques sans garantie de soutien durable ou de reconnaissance de ses contraintes propres. le rapport vise à définir les moyens de développement de l’ESS et à identifier les freins à sa croissance, dans l’ambition de doter la France d’une politique ambitieuse pour ce secteur. Il formule quatre grandes orientations et 50 propositions concrètes pour mieux connaître, accompagner et intégrer l’ESS dans les politiques publiques.
Les classiques
- La Grande Transformation, aux origines politiques et économiques de notre temps, Karl Polanyi, 1944
Polanyi part du principe qu’on ne peut comprendre un fait économique de manière isolée mais qu’il faut l’analyser dans son contexte social et historique global. L’ouvrage identifie alors le désencastrement comme processus clé de l’ère moderne : l’économie a été artificiellement séparée de la société pour devenir une sphère autonome et dominante. Cette situation est fondamentalement instable car, au cœur de la société, se trouvent des valeurs de dignité humaine, de cohésion sociale, de sécurité et de stabilité. Parce que les humains ne sont pas des marchandises, ils ne peuvent supporter la destruction causée par cette logique marchande. En tant qu’êtres sociaux, ils réagiront donc toujours pour se protéger, créant un « contre-mouvement » défensif qui, par ses actions, finit par gripper et déstabiliser le système de marché lui-même.
L’auteur suggère que toute politique publique doit être évaluée non pas sur son efficacité économique, mais sur sa capacité à ré-encastrer l’économie dans la société. Une application concrète de cette vision serait de renforcer les « contre-mouvements » protecteurs au niveau local, par exemple en donnant aux communautés un droit de veto sur les projets économiques majeurs basé sur des critères sociaux et environnementaux, et non plus seulement économiques.
- Economie et société, Max Weber, 1922
Cet ouvrage majeur de sociologie analyse les liens complexes entre les sphères économique et sociale. Publié à titre posthume en 1921-1922, est l’œuvre majeure du sociologue allemand Max Weber. Economie et société s’articule autour de l’étude des formes d’organisation sociale, des relations de pouvoir et des mécanismes de domination.
Weber identifie trois types de domination légitime : la domination rationnelle-légale (fondée sur la légalité et la croyance en des règles impersonnelles), la domination traditionnelle (fondée sur la coutume et l’héritage) et la domination charismatique (fondée sur le prestige personnel d’un chef).
Weber analyse la rationalisation croissante des sociétés modernes, notamment à travers le développement du capitalisme et de la bureaucratie, qui favorisent une organisation rationnelle et calculable des activités économiques et administratives. Il insiste sur la tension constante entre différentes sphères d’activité (économie, religion, droit) et sur les conflits de valeurs qui en résultent. L’économie est envisagée non pas isolément, mais dans ses interactions avec les institutions, les organisations et les types de comportement humain.Ce vaste essai de Weber, inachevé, constitue la pierre angulaire de la sociologie compréhensive. L’idée est de saisir la logique interne des acteurs pour expliquer les phénomènes sociaux.
- Coopération économique et sociale, Charles Gide, 1886-1904
Ce texte détaille tout d’abord méticuleusement les origines des coopératives de consommation, en commençant par les « Équitables Pionniers de Rochdale » en 1844. Il décrit leurs humbles débuts (« petite épicerie » ) et leur croissance rapide en une force économique massive. Également les principes fondateurs, à savoir la vente à prix fixe et au comptant , la fixation du prix des marchandises de manière à laisser un bénéfice , la répartition de ce bénéfice aux membres en fonction de leurs achats , l’octroi d’un intérêt statutaire limité sur le capital , et la règle démocratique « un homme = une voix »
La grande vision de Gide, la « République Coopérative », est directement liée à l’expansion des coopératives de consommation, qui finiraient par contrôler non seulement la distribution mais aussi la « production » et l' »agriculture ». L’objectif de la coopérative, selon Gide, est de « modifier pacifiquement mais radicalement le régime économique actuel » , d’établir le « juste prix » , de « moraliser la pratique commerciale » et de promouvoir la solidarité.
Gide suppose un impératif moral et éthique fondamental pour l’organisation économique. Son insistance sur la solidarité en tant que « contrat social » et « obligation morale » suggère une conviction que la nature humaine, lorsqu’elle est correctement cultivée, s’orientera vers l’altruisme et le bien-être collectif plutôt que vers le gain individuel.
La singularité de l’œuvre de Gide réside dans sa re-centration radicale de la théorie économique autour du consommateur et de la consommation. Alors que de nombreuses théories économiques et sociales de son époque se concentraient sur la production (par exemple, l’économie classique, le marxisme), Gide affirme audacieusement que le consommateur, souvent négligé, est le véritable souverain et le moteur ultime de l’activité économique.
Pour aller plus loin
- Avise
- Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale (CNCRES)
- ESS France
- Le Labo de l’ESS
- La lettre de l’Economie Sociale
- Mouvement des entreprises écologiques, sociales, solidaires
Ressources en évaluation
- Evaluation de politiques publiques
- Gouvernance de l’évaluation
- Guides et manuels de suivi évaluation
Date de publication : 2010
Dernière actualisation : 2025
Edition : Sébastien Galéa